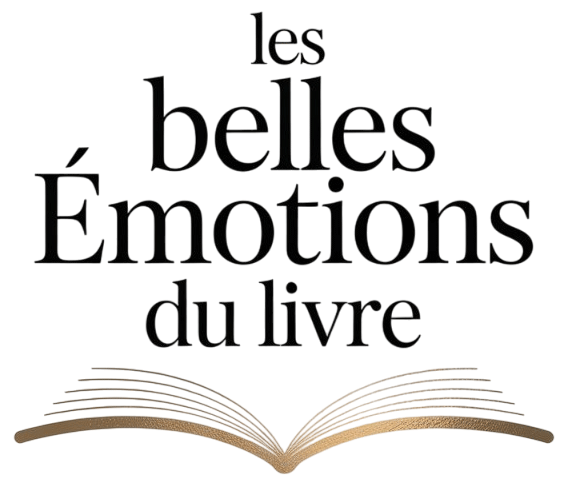Les témoignages recueillis en résidence révèlent l’attachement, parfois discret mais profond, à une quête de sens et à la transmission : « Ma spiritualité se nourrit des petits rituels du quotidien : voir le jardin le matin, discuter avec des amis de ma génération, allumer une bougie pour penser aux absents... », confie une résidente de 83 ans à la Résidence Les Jardins d’Arcadie à Lille. « Plus que la religion, c’est la méditation et l’écoute de la musique qui me réconcilient avec mes souvenirs », témoigne un autre résident.
Entre soutien au moral, stimulation de la curiosité et cohésion du groupe, la dimension spirituelle devient ainsi un socle discret mais déterminant de l’accompagnement global. De plus en plus de familles choisissent leur établissement en fonction de cette ouverture à la diversité des parcours intimes, signe d’une société vieillissante mais moins cloisonnée dans ses approches.
L’appréhension de la spiritualité, adaptée à chaque personnalité, contribue à la dignité de la vieillesse et accompagne l’avancée en âge dans toutes ses dimensions. Les résidences services l’ont bien compris : en offrant cet espace de liberté intérieure et d’expression, elles participent à bâtir un environnement apaisant, où chacun peut vieillir... à sa façon.