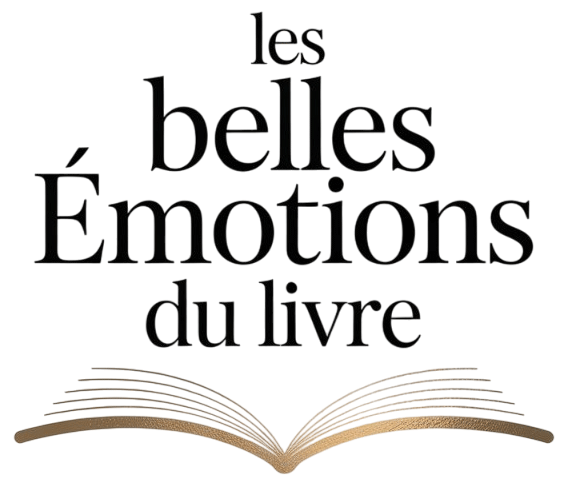Loin du tumulte des plateaux télé et des réseaux sociaux, l’édition généraliste travaille dans la durée. Les grandes maisons telles que Gallimard, Grasset, Le Seuil, Albin Michel ou Fayard jouent un rôle central dans la sélection, la diffusion et la légitimation des idées. Leur puissance n’est pas seulement économique : elle est symbolique, sociale et politique. En France, patrie de l’écrit et de la dissertation, qui façonne les contours de la pensée ? Beaucoup regardent vers les auteurs ; mais ce sont aussi – surtout – les éditeurs qui organisent la circulation des voix, en choisissant ce qui doit être lu, discuté, puis transmis.
Dans cette architecture subtile, les grandes maisons généralistes tiennent la position de l’aiguilleur : elles décident, en amont, quels textes accéderont à une visibilité nationale, façonneront l’actualité intellectuelle et parfois influenceront jusque dans les couloirs du pouvoir.