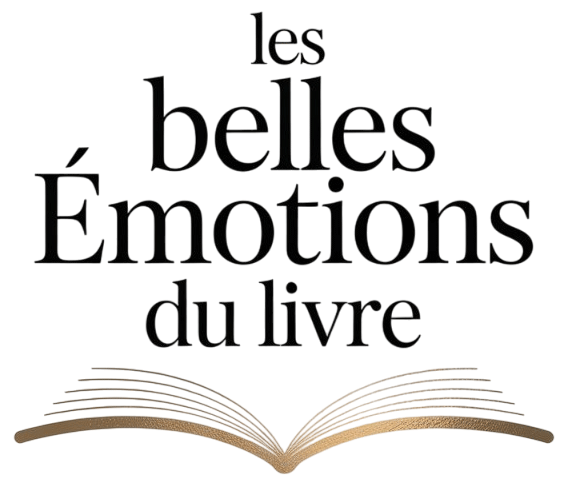L’avenir du marché éditorial français reste suspendu à cette tension féconde — parfois violente — entre géants et artisans du livre. Si les grandes maisons généralisent la concentration de la distribution, de la visibilité et du pouvoir symbolique, elles risquent d’étouffer la vivacité même qui fait de la littérature un espace de rencontres inattendues, de mises en question, de renouvellements constants.
La bibliodiversité française — ce terme devenu étendard dans toutes les manifestations littéraires — ne peut survivre que par l’existence d’un tissu solide d’éditeurs indépendants, de libraires curieux et engagés, de lecteurs prêts à sortir des sentiers battus. Dans ce contexte, la vigilance collective est plus que jamais de mise, car la pluralité n'est jamais définitivement acquise. Les prochaines années diront si l’édition française saura protéger cette précieuse capacité à faire émerger la surprise, l’incertain et, in fine, l’émotion du livre vivant.