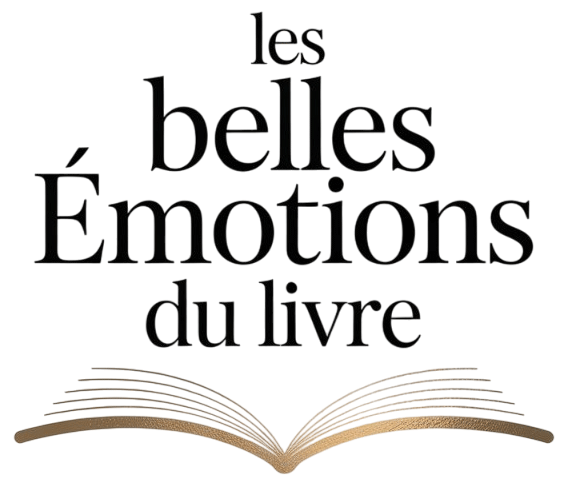L’influence des grandes maisons généralistes sur la lecture de société s’articule toujours entre promesse de rayonnement et risque d’uniformisation. L’essor du numérique, l’émergence de l’autoédition et la prise de parole croissante d’auteurs issus d’horizons variés sont venus fragiliser ce monopole, proposant d’autres voies pour raconter la société.
Toutefois, le cœur battant des dynamiques de lecture demeure encore, pour une large part, dans les murs feutrés des grandes maisons qui choisissent, fabriquent, diffusent, et promeuvent les ouvrages qui nourrissent notre imaginaire collectif et notre conscience sociale. Au lecteur d’interroger sans relâche ces influences, d’ouvrir les livres au-delà des vitrines, et de s’aventurer le long de chemins moins balisés pour continuer à s’émouvoir, réfléchir et comprendre ce monde qui ne cesse de s’écrire.
Sources : Syndicat national de l’édition ; Livres Hebdo ; CNL ; Observatoire de l’économie du livre ; GfK 2022 ; Le Monde ; Le Figaro ; France Inter ; Bibliodiversité en question ; entretiens éditeurs, 2017-2023.