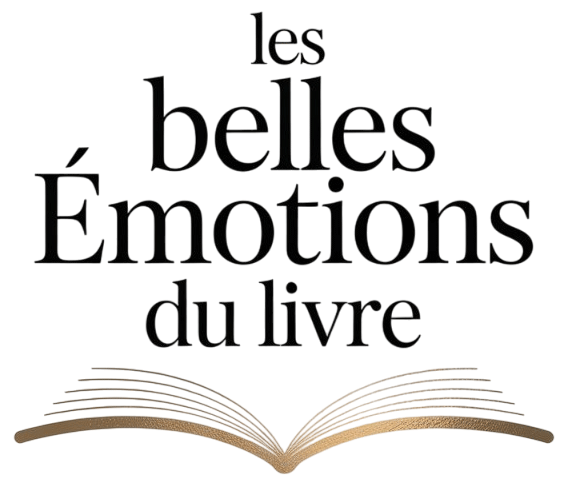Le premier roman, longtemps tenu pour parent pauvre du monde éditorial, bénéficie pourtant en France d’un intérêt affirmé. Lors de la rentrée littéraire 2023, sur les 466 romans français publiés entre août et fin septembre, 84 étaient des premiers romans, soit un peu plus de 18 % (source : Livres Hebdo). Ce chiffre reste stable par rapport à l’année précédente, mais il marque une réalité : la France demeure un pays où chaque rentrée est guettée pour ses nouvelles voix.
Toutefois, cette dynamique ne doit pas masquer que l'immense majorité de ces textes paraissent chez des éditeurs de taille moyenne ou petite. Les grandes maisons – Gallimard, Grasset, Albin Michel, Le Seuil, Laffont, Flammarion, Stock –, bien que soucieuses de renouveler leur catalogue, retiennent leur enthousiasme. On note, par exemple, qu’en 2021, Gallimard a publié cinq premiers romans, Le Seuil trois, Grasset deux, alors que chacun publie entre 25 et 40 romans lors d’une rentrée. Cette proportion, d’environ 10-15 %, reste faible et montre la prudence qui domine la politique de ces groupes.