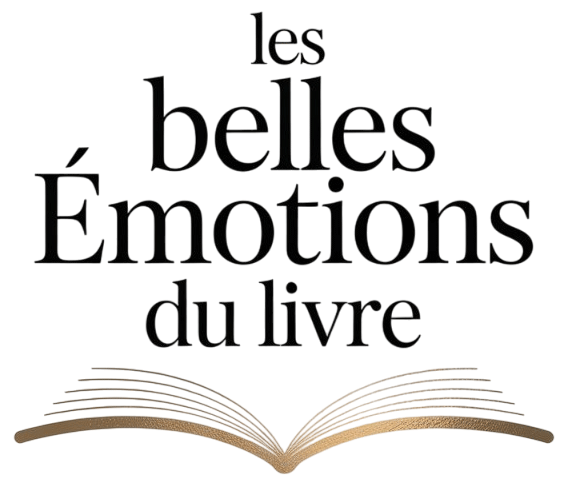Le paysage littéraire français repose sur un équilibre subtil et passionnant entre les grandes maisons d’édition généralistes – Gallimard, Flammarion, Albin Michel, Le Seuil, pour ne citer qu’elles – et les librairies, qu’elles soient indépendantes, de chaîne ou en ligne. Cette alchimie porte en elle le souffle de l’histoire du livre français : une tradition de dialogue constant, de partenariat respectueux, tissé d’exigences littéraires et d’enjeux économiques.
La France, forte de son fameux “prix unique du livre” instauré par la loi Lang en 1981, protège le maillage territorial exceptionnel de ses librairies – on en compte plus de 3 500 indépendantes en 2023 selon le Syndicat de la librairie française (SLF). Face à elles, les grandes maisons d’édition ne sont pas de simples fournisseurs, mais des alliés attentifs… et parfois des négociateurs rigoureux. Ce lien, si vivant, n’est jamais figé : il se réinvente sans cesse, sous l’impulsion des nouvelles pratiques de lecture, de la montée du numérique et de la concentration éditoriale.